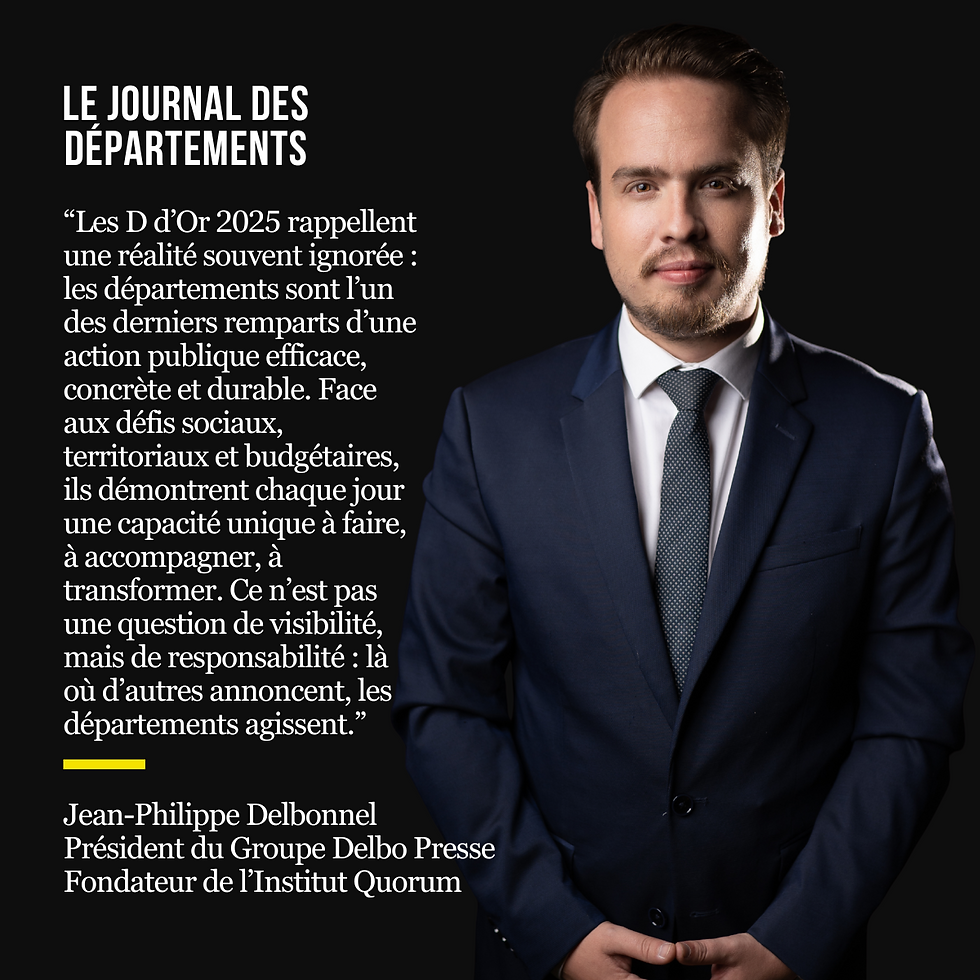Depuis sa création en 1935, UPSA porte une conviction forte : fabriquer en France est un choix stratégique, économique et sociétal.
Implantée au cœur du Lot-et-Garonne, où elle est le premier employeur privé, UPSA incarne un modèle industriel à la fois responsable et durable.
À l’heure où la réindustrialisation s’impose comme une priorité nationale, UPSA démontre qu’un "Fabriqué en France" exigeant, compétitif et durable est non seulement possible, mais nécessaire.
Mais chez UPSA, produire en France ne suffit pas — nous défendons une vision plus large : celle de la responsabilité territoriale d’entreprise.
Notre modèle repose sur des projets qui nous font grandir autant qu’ils font grandir notre territoire et ses acteurs.
Notre intime conviction, c’est que notre ancrage territorial ne doit pas se limiter à la production, mais bien s’inscrire dans une véritable chaîne de valeur qui bénéficie à l’emploi local, à la fiscalité territoriale, à l’environnement, et à la résilience nationale.
Pour UPSA, faire du « fabriqué en France » est une conviction pour soutenir l’industrie française et assurer la souveraineté sanitaire. À Agen, sur nos deux sites de production, 100 % de nos médicaments à base de paracétamol – dont les marques emblématiques Dafalgan et Efferalgan – sont conçus et fabriqués en France. Ce sont aujourd’hui plus de 350 millions de boîtes produites chaque année, faisant d’UPSA le premier site français de fabrication de médicaments à base de paracétamol en France. Durant le COVID, UPSA n’a pas connu de ruptures d’approvisionnement grâce à ses collaborateurs et à la force de ses outils industriels dans lequel nous investissons chaque année plusieurs millions d’euros. UPSA s’est également engagée dans le processus de relocalisation du principe actif paracétamol aux côtés de Seqens et Ipsophène et sera le premier laboratoire à fabriquer du Paracetamol 100% fabriqué en France. Fidèle à notre raison d’être, nous nous sommes engagés à produire deux molécules essentielles.
Le choix de produire en France c’est aussi un enjeu de création de valeur territoriale. UPSA par sa présence génère des emplois directs et indirects et contribue à la fiscalité locale, ce qui renforce le tissu économique de notre territoire. L’engagement d’UPSA en Lot-et-Garonne est total. En 2024, UPSA a soutenu près de 5 000 emplois à temps plein en France. On compte parmi eux les emplois directs du groupe avec 1700 collaborateurs, mais aussi plus de 600 emplois soutenus dans la chaîne de fournisseurs grâce aux achats français, et plus de 2 700 emplois induits grâce aux salaires versés et à la fiscalité collectée par les administrations publiques. Ainsi, pour un emploi direct d’UPSA, deux emplois supplémentaires sont soutenus dans l’économie nationale. Notre impact à l’échelle du Lot-et-Garonne reste très marqué puisque notre activité représente 4 % du produit intérieur brut du département. Fidèle à notre engagement en faveur d'une responsabilité territoriale d'entreprise, nous avons lancé une initiative inédite : l’Académie des élus. Conçue comme un espace d’échanges et de formation, elle réunit les élus locaux – maires et conseillers municipaux – afin de partager nos enjeux d’entreprise et ceux du bassin agenais. Cette démarche permet non seulement de renforcer le dialogue entre acteurs publics et privés, mais aussi de faire découvrir concrètement nos activités en ouvrant les portes de nos usines. À travers cette initiative, nous affirmons notre vision de la Responsabilité Territoriale d’Entreprise : agir ensemble, sur le terrain, pour créer de la valeur durable au service du territoire.

Le choix de produire en France est aussi un acte fort en faveur de la transition écologique. En maintenant nos sites industriels sur le territoire national, nous contribuons à la réduction de l’empreinte carbone du pays. Chez UPSA, 80 % de nos fournisseurs sont basés en France, ce qui limite les transports longs et renforce les circuits courts. Notre engagement environnemental se traduit également par un plan ambitieux de décarbonation de nos sites industriels, avec pour objectif une réduction de 60 % de nos émissions de gaz à effet de serre (GES) sur les scopes 1 et 2 d’ici à 2030. Par ailleurs, 100 % des emballages de nos nouveaux produits sont conçus selon des critères stricts d’éco-conception, intégrant à la fois la réduction des matériaux, leur recyclabilité et l’optimisation logistique.
Enfin, le choix de produire en France c’est contribuer au rayonnement international et à l’attractivité de la marque française. Le « Made in France » est un label de confiance partout dans le monde. Nos produits Efferalgan et Dafalgan sont leaders sur de nombreux marchés internationaux.
60 % de notre chiffre d’affaires est réalisé à l’export, dans plus de 60 pays. Cela témoigne de la solidité de la marque UPSA et de l’attractivité de la qualité française. D’après une étude réalisée en 2024 par le réseau CCI France en collaboration avec l’Institut OpinionWay : ses résultats révèlent que le made in France est appréciée en raison de sa réputation associée à la qualité, à l’image positive des marques mais aussi à leur engagement.
Pourtant, ces externalités positives sont encore trop absentes du débat public. Alors que la France s’engage dans une phase cruciale de rééquilibrage de ses finances publiques, le débat économique demeure figé dans un dualisme devenue stérile : faut-il réduire les dépenses publiques ou alourdir la fiscalité ? Cette polarisation, répétée à l’envi, ne rend plus compte de la complexité des enjeux ni des leviers réellement disponibles.
Chez UPSA, nous sommes convaincus qu’une autre voie existe : celle de la réindustrialisation et du soutien actif à la production nationale. Acheter un bien fabriqué en France, c’est bien plus qu’un choix de consommation : c’est un acte économique et politique fort et mesurable. Chaque achat soutient les entreprises qui produisent sur notre territoire, consolide l’emploi local, génère des recettes fiscales et réduit la dépense sociale. Chez UPSA, nous en sommes un exemple tangible.
La France est grandement dépendante des importations, qui dépassent aujourd’hui 650 milliards d’euros par an qui ne contribuent ni au financement de nos services publics ni à celui de notre modèle social. Ils alourdissent notre déficit commercial, nourrissent notre dette extérieure et réduisent les marges de manœuvre de la puissance publique.

Selon les travaux de la mission « Fabriqué en France », relocaliser seulement 10 % des biens consommés par les ménages français représenterait un gain de production nationale de 11,2 milliards d’euros, et la création de 150 000 emplois. Par ailleurs, le Made in France reste aujourd’hui un véritable « trou noir » de la commande publique. Le potentiel additionnel des achats publics de produits français est estimé à 15 milliards d’euros — soit près d’un cinquième du déficit commercial enregistré en 2024. Réserver ne serait-ce que 25 % des marchés publics aux produits français représenterait un levier de 50 milliards d’euros d’achats annuels en soutien direct à notre tissu productif.
C’est la raison pour laquelle nous appelons à un véritable tournant, qui reconnaisse enfin la valeur de ceux qui fabriquent en France et qui font vivre nos territoires.
Ce combat pour la défense du fabriqué en France doit se déployer sur tous les fronts : dans nos gestes quotidiens comme dans l’élaboration des politiques publiques. À l’heure où chaque euro dépensé compte, privilégier des biens et services issus du territoire national, intégrer la localisation de la valeur ajoutée dans la commande publique, soutenir les filières industrielles locales ne relèvent pas de l’isolationnisme ni du nationalisme économique. C’est reconnaître que produire en France génère des emplois, nourrit les recettes fiscales, assure le financement de la sécurité sociale, favorise l’investissement productif et bâtit une résilience économique durable. C’est par cette voie collective et engagée que nous pourrons sortir des impasses actuelles et assurer un avenir solide, souverain et prospère pour notre pays.

Laure Lechertier, Directrice de l'accès au marché, des affaires publiques, de la communication et de la responsabilité sociétale d'entreprise d'UPSA. Membre du comité exécutif d’UPSA Groupe.